[ACCESSIBILITÉ] L’accessibilité numérique : premières notions
Le handicap est défini directement dans les textes de loi. Selon l’Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, le handicap se reconnaît par :
“Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.”
Pour connaitre les différents types de handicap, consultez ce tutoriel :
L’accessibilité numérique consiste à rendre les contenus et services numériques perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes par tous et sur tout type de supports (ordinateur, téléphone portable, tablette…). Cela signifie que les personnes en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, cognitif…) et les personnes âgées sujets à ces troubles peuvent utiliser les interfaces en question. Chaque utilisateur doit pouvoir percevoir, comprendre, naviguer et interagir sans aucune difficulté, ni discrimination.
“Aujourd’hui, si l’on est optimiste, on va dire que moins de 10% des sites internet sont accessibles en France. Si on est un peu plus réaliste, ce pourcentage doit se situer entre 3 et 4% des sites internet.” Manuel Pereira, Directeur du pôle accessibilité de l’association Valentin Haüy
L’accessibilité web est encadrée par des normes, dont le niveau d’exigence varie selon la situation géographique.
En France, il existe un référentiel, nommé le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité).
Au niveau international, on trouve le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
Le RGAA n’est pas le WCAG transposé en français. Ces deux référentiels sont en réalité complémentaires : le premier apporte davantage des méthodes, d’aides à la mise en œuvre alors que le second liste des critères et des recommandations.
Le RGAA compte 106 critères et 3 niveaux de conformité :
➔ Non conforme (moins de 50% des critères remplis),
➔ Partiellement conforme (50% et plus),
➔ Conformité totale (100% des critères).
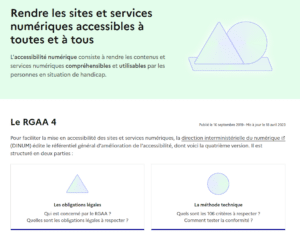
Le cadre légal mentionné précédemment est précis. Il s’agit, pour les sites du service public et les entreprises réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires de :
➔ proposer des interfaces en conformité avec le RGAA ;
➔ informer les utilisateurs de la conformité ou non de leurs interfaces avec les critères du RGAA grâce à une déclaration d’accessibilité. Celle-ci doit préciser si le site est “non conforme”, “partiellement conforme” ou “conforme” ;
➔ indiquer le statut de conformité dès la page d’accueil ;
➔ offrir la possibilité à l’utilisateur de signaler ses difficultés et de lui porter assistance dans un délai raisonnable ;
➔ publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité, renouvelé au plus tard tous les 3 ans.
Depuis le 1er janvier 2024, les sites de l’internet public non accessibles aux personnes handicapées peuvent faire l’objet de sanctions à hauteur de 50 000 euros. En rapport avec les objectifs de la loi “handicap” de 2005, le but est que les démarches en ligne les plus courantes soient accessibles fin 2025. Contrairement aux précédentes directives, un organe de contrôle indépendant a été choisi pour appliquer les sanctions : L’ARCOM.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) est compétente pour identifier et constater les manquements, en s’appuyant notamment sur des méthodes de collecte automatisée, émettre des injonctions préalables aux sanctions.
Si un manquement sanctionné persiste plus de six mois après l’imposition de la sanction initiale, une nouvelle sanction pourra être imposée (au lieu d’un an auparavant).
